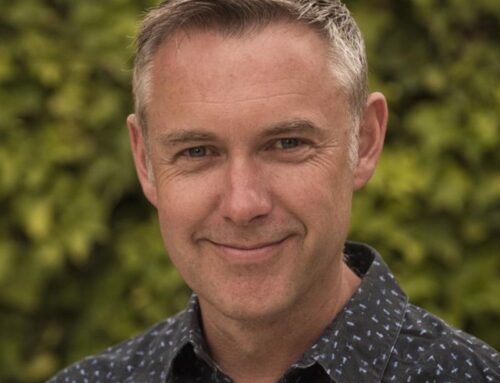Entretien avec Nick Westcott, Professeur à SOAS et ancien Directeur au SEAE et Julien Serre, fondateur et dirigeant de Whaydon
Alors que le conflit entre Israël et le Hamas continue de faire rage, et que la situation humanitaire à Gaza inquiète, nous avons le plaisir ce mois-ci de dialoguer avec deux invités : Nick Westcott, Professeur à SOAS (Londres) et ancien Directeur Moyen-Orient au Service européen d’action extérieure (SEAE) et Julien Serre, fondateur et dirigeant de Whaydon, une nouvelle société de conseil en intelligence stratégique positionnée sur les questions industrielles européennes et les questions internationales, en particulier dans les États fragiles. Avec eux, nous revenons sur le positionnement de l’UE sur le conflit, ses lacunes et leviers d’action, ainsi que sur la question de la reconstruction de Gaza.
Q1. Nick Westcott, comment avez-vous observé les prises de positions des différents gouvernements européens sur le conflit entre Israël et le Hamas après les attentats terroristes du 7 octobre dernier ? Avez-vous noté des positionnements inattendus par rapport aux lignes de divisions traditionnelles ? Est-ce que, d’après vous, les gouvernements européens parviennent progressivement à avoir chacun des positions plus équilibrées, qui soient en phase avec l’évolution notable de leurs propres opinions publiques ?
Les États européens ont traditionnellement adopté une position commune sur le processus de paix au Proche-Orient, soutenant une solution à deux États dans la ligne des Accords d’Oslo. Cependant, au sein de ce consensus, il a existé un champ de positions différentes en ce qui concerne les démarches que l’Europe pourrait faire pour soutenir cette solution. Collectivement, la relation institutionnelle principale de l’UE avec Israël a été un Accord d’Association qui inclut des mesures de libéralisation commerciale, étant entendu que les biens en provenance des Territoires occupés (TO) ne peuvent pas être labélisés comme « israéliens » dans le cadre de cet Accord. L’expansion des colonies au sein des TO fait également l’objet d’une contestation de tous les États membres. Aux plans nationaux, certains États européens comme l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce et Chypre ont traditionnellement davantage soutenu la position israélienne que d’autres (Belgique, Irlande, France), qui ont été plus sensibles à la cause palestinienne. Les gouvernements ont assez largement reflété les positions de leurs opinions publiques.
Les évènements observés depuis les attaques du 7 octobre ont néanmoins conduit à une plus grande polarisation des opinions au sein des pays européens plutôt qu’entre eux. Ceci a placé plusieurs gouvernements devant des situations politiques délicates puisqu’ils ont été conduits à contenir l’expression d’opinions tantôt antisémites et tantôt islamophobes. La réaction initiale de l’UE a également été confuse et suscité par la même un certain embarras. Le Commissaire chargé du voisinage, responsable de l’aide de l’UE aux Palestiniens a d’abord indiqué que l’ensemble de l’aide serait immédiatement suspendu, avant de se reprendre en indiquant qu’elle ferait l’objet d’une revue, puis de la réinstaurer au regard du fait qu’elle ne bénéficiait pas au Hamas. On a également observé des différences de vues significatives entre la présidente von der Leyen et le Haut-Représentant Borrell, ce dernier soulignant l’importance du respect du droit international humanitaire. Malgré ces divergences, les pays européens ont noté un soutien croissant des opinions en faveur d’un cessez-le-feu immédiat dans un contexte où le nombre de victimes à Gaza augmentait. La plupart d’entre eux soutiennent désormais une cessation des combats aussi rapide que possible.
Q2. Julien Serre, l’UE, ses États membres et ses institutions, parait toujours embarrassée par le dossier israélo-palestinien, depuis ses origines et au travers des différents conflits qui l’émaillent. Pourtant, avant même de considérer les enjeux de politique étrangère et de défense, l’UE apporte une contribution non négligeable au développement socio-économique et humain d’Israël et de l’Autorité palestinienne, ainsi que dans les pays limitrophes. Pouvez-vous rappeler quels sont les outils dont dispose l’UE dans la région ?
Entre 2014 et 2020, l’UE a fourni 2,2 milliards d’euros d’aide bilatérale aux Palestiniens, ce qui a eu un impact significatif sur le développement socio-économique et humain à Gaza et en Cisjordanie, mais sans stratégie cohérente. Cette approche décousue, malgré sa nature globale, vise à favoriser la stabilité, la paix et la prospérité régionales.
Les efforts de l’UE englobent l’aide humanitaire, le soutien aux familles palestiniennes par l’intermédiaire de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et PEGASE (un instrument de gestion de l’aide socio-économique entre l’UE et la Palestine), en particulier dans le cadre d’un conflit. En matière de gouvernance, il se concentre sur la construction de l’État pour l’Autorité palestinienne, avec un travail important dans le domaine du renforcement des institutions, de la gouvernance, de l’État de droit et du développement du secteur privé, illustré par la mission « EUPOL COPPS » à Ramallah.
Le partenariat UE-Palestine est étayé par l’accord d’association intérimaire de 1997 et le plan d’action UE-Palestine de 2013, qui fait partie de la politique européenne de voisinage (PEV), récemment prolongée jusqu’en 2025. Malgré les restrictions israéliennes, l’UE a lancé des projets visant à stimuler l’économie palestinienne, notamment des garanties de crédit et des formations professionnelles.
L’engagement auprès de la société civile comprend des programmes tels que le « Partenariat pour la paix » et l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme, qui abordent des questions liées à l’occupation. Au niveau régional, des initiatives telles que l’Initiative européenne pour la consolidation de la paix soulignent l’engagement de l’UE en faveur de la démocratie, de la fourniture de services durables et du développement économique.
Les contributions financières de l’UE et des États membres comme l’Allemagne et la France ont varié, l’aide globale des donateurs du CAD de l’OCDE ayant augmenté depuis 2000. La Banque européenne d’investissement (BEI) collabore avec la Palestine dans des secteurs tels que l’énergie, l’eau et les transports, avec plus de 600 millions d’euros investis.
Dans l’ensemble, les grands projets d’infrastructure se trouvent plutôt en Israël, où la BEI opère conformément à la politique européenne de voisinage (PEV). À titre de comparaison, imaginons que la BEI ait financé quatre partenariats public-privé liés aux usines de dessalement d’eau de mer par osmose inverse, ce qui représente 560 millions d’euros.
Ces engagements, bien qu’importants, ne sont pas largement connus des citoyens de l’UE. La diversité des niveaux d’aide et l’absence d’approche unifiée mettent en évidence les difficultés à harmoniser la position de l’UE sur le conflit israélo-palestinien. Les efforts récents comprennent l’augmentation de l’aide humanitaire aux Palestiniens, avec environ 70 millions d’euros alloués pour 2023. Cette augmentation, ainsi que l’aide d’urgence de 20 millions de dollars de la Banque mondiale pour Gaza, reconnaissent les limites actuelles de l’absorption des ressources dans la région.
Q3. Nick Westcott, le positionnement diplomatique et de défense modeste de l’Union européenne sur le dossier israélo-palestinien ne doit sans doute pas laisser oublier les leviers d’action dont l’UE dispose ni l’attente de plusieurs parties prenantes au conflit ou à sa résolution de la voir jouer un rôle plus important à l’avenir. La paix, la sécurité, la prospérité, les valeurs de l’Union européenne sont en jeu. D’après vous, comment le positionnement européen pourrait-il être davantage renforcé sur ce conflit ?
Les leviers de l’UE sont principalement économiques plus encore que diplomatiques, et ils devraient être déployés pour soutenir une solution à deux États viable. Le commerce avec l’UE sera aussi important pour un État palestinien que pour Israël : l’UE devrait donc insister pour un traitement égal des termes de l’échange et par ailleurs fournir un soutien financier pour les besoins humanitaires et de développement des Palestiniens.
Cependant, pour le moment, l’UE apparait comme un observateur passif des négociations. Outre la France, Malte est actuellement le seul autre État membre de l’UE à siéger au Conseil de Sécurité, où les négociations sur une résolution de cessez-le-feu ont lieu. Les États-Unis, les Émirats arabes unis (EAU), l’Égypte et le Qatar sont ceux qui sont les plus impliqués ; or, sans une position claire et unie, les intérêts de l’Europe ne seront pas pris en compte. Pourtant, l’UE a des intérêts majeurs dans la stabilité de la région et dans une solution stable au contentieux israélo-palestinien. Ce n’est qu’en s’accordant sur une position commune et prospective et en nommant un poids lourd politique comme envoyé spécial dans la région que l’UE pourra apporter une contribution efficace et nécessaire au processus de paix et la présenter à ses partenaires arabes et américain. La proximité et les liens économiques de l’UE avec la région sont les meilleures garanties qu’une solution sera économiquement bénéfique aux deux parties.
Comme on a pu l’observer au cours des deux derniers mois, il est illusoire de construire des écoles et des cliniques à Gaza si celles-ci sont ensuite détruites, ou de soutenir des entreprises et des projets en Cisjordanie si celle-ci est étranglée par des colons. L’UE devrait donc se positionner rapidement en soutien à des négociations porteuses, qui seront le seul moyen de fournir aux deux parties la sécurité dont elles ont besoin et la liberté politique qu’elles méritent.
Q4. Julien Serre, vous avez récemment signé une tribune remarquée dans le quotidien français Les Echos sur la contribution que pourrait apporter l’UE à la reconstruction de Gaza, un enjeu qui reste en deçà des radars géopolitiques. Vous appelez en particulier de vos vœux une contribution à la sécurité, à la sécurité humaine, au « continuum de reconstruction » ainsi qu’au multilatéralisme. Pouvez-vous expliciter pourquoi le positionnement de l’UE sur cette question est si important et la valeur ajoutée qu’elle pourrait apporter ?
Dans mon éditorial pour Les Echos, j’ai souligné le rôle crucial de l’Union européenne dans la reconstruction de Gaza, rejetant l’idée d’une Europe faible et inefficace. Ma proposition se concentre sur l’aide humanitaire immédiate et sur l’établissement d’une paix et d’une stabilité à long terme. Il s’agit notamment de tirer parti de l’influence économique et géopolitique de l’UE pour soutenir la consolidation de la paix, la sécurité et le développement, et de plaider en faveur d’une solution à deux États pour Israël et la Palestine.
La contribution sous-estimée de l’UE à la sécurité régionale implique des opérations d’assistance technique de haute qualité, qui ciblent également le financement du terrorisme, s’alignant sur l’engagement de l’UE à maintenir la sécurité régionale et à soutenir les efforts internationaux comme en Ukraine.
Le concept de « sécurité humaine » est essentiel, car il englobe non seulement la sécurité physique, mais aussi l’accès aux services essentiels. Les projets visant à améliorer les conditions de vie à Gaza, tels que les systèmes de dessalement et d’approvisionnement en électricité, sont indispensables. L’expertise de l’UE en matière de mise en œuvre de projets, par l’intermédiaire d’organisations telles que la BEI et l’Agence française de développement, garantit une utilisation efficace des ressources et la réussite de projets d’infrastructure à grande échelle.
Le soutien au système multilatéral est un élément clé de la stratégie de l’UE. Les Nations unies, soutenues par l’UE, peuvent apporter une réponse globale aux défis de Gaza, notamment en renforçant le rôle de la coordinatrice pour les territoires palestiniens, Sigrid Kaag, et en mobilisant des agences clés telles que le PNUD et l’UNOPS, aux côtés des institutions financières internationales. Le 22 décembre 2023, le Conseil de sécurité a adopté une résolution légère appelant à une augmentation de l’aide aux civils dans la bande de Gaza.
Les Européens, qui partagent les inquiétudes des États-Unis quant au risque de débordement régional du conflit israélo-gazaoui, ont besoin d’un plan d’action des Nations unies pour la paix et la sécurité. L’indication par Josep Borrell d’une solution à deux États et de la nécessité d’organiser des élections palestiniennes représente une voie viable pour l’avenir. L’unité de l’Europe est essentielle pour apporter une réponse forte et constructive au conflit.